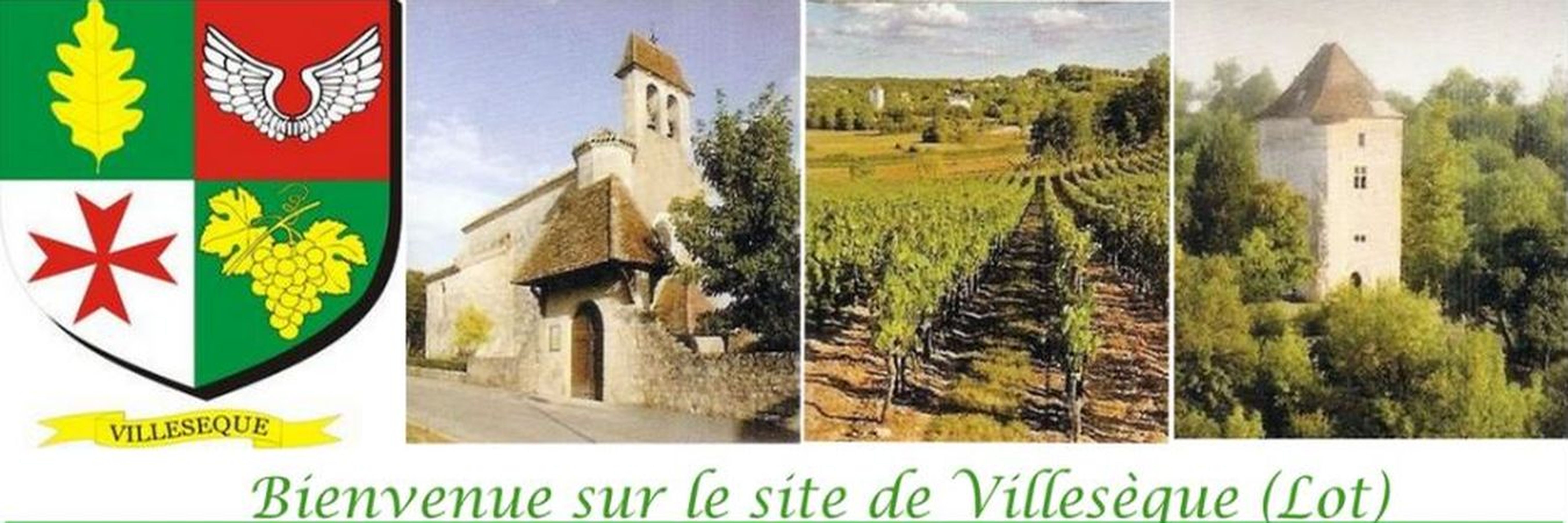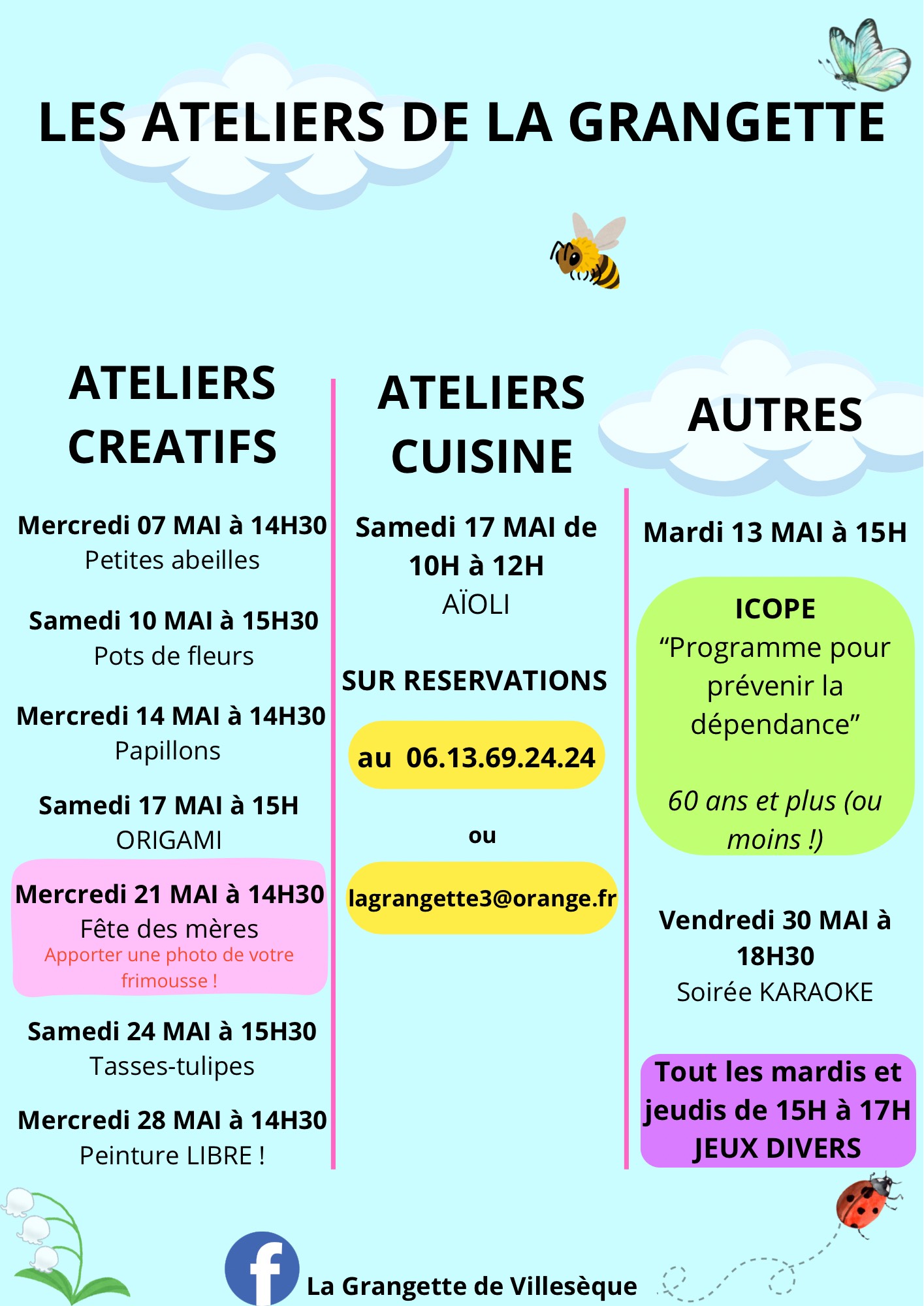Les rails Cahors Moissac
Histoire d’une des lignes de chemin de fer oubliées :
Ligne CAHORS MOISSAC.
Pour la prospérité commerciale d'un pays, les voies de communications et de transport, route, fer, eau, air, doivent être développées en premier et en harmonie avec le contexte économique du pays.
Napoléon 1er(1769 -1821) avait lui aussi compris vers l'an 1800 que le réseau routier français était insuffisant, tout comme Charles de Freycinet (1828 -1923), Ministre de la Guerre en 1870. La Prusse a gagné la guerre contre la France en 1870 grâce à une organisation ferroviaire et à une utilisation intensive des chemins de fer en arrière des lignes de combat. Bien entendu, ces deux grands hommes avaient à l'époque une pensée militaire, dans le but de faciliter le déplacement des troupes.
Mais ce qui peut servir à l'armée peut, en temps de paix, servir à des fins commerciales. En 1830 fut établie la première ligne ferroviaire de St Etienne à Andrézieux, et en 1877 M.le Ministre des Travaux Publics Charles de Freycinet fit établir un plan pour la mise en place d'un réseau ferroviaire dense (train + tramway) et la création de canaux avec agrandissement et aménagement des ports. Celui‑ci a été aussi : Maire de Beaumont de Lomagne, Conseiller Général et Sénateur du Tarn‑et‑Garonne.
C'est ainsi que prit naissance la nouvelle ligne ferroviaire CAHORS‑MOISSAC qui à marquée une partie de l’ histoire de notre région et de Villesèque.
Abréviations utilisées dans le texte :
LCM = Ligne de Cahors à Moissac
PRA = Pont Rail
PRO = Pont Route
PK = Point kilométrique ferroviaire
L'établissement de la ligne Cahors‑Moissac, mettant en communication la partie Nord-Ouest du département du Tarn‑et‑garonne avec la partie Sud‑Ouest du département du Lot a été reconnue d'intérêt général suite au plan Freycinet, Ministre des Travaux Publics en 1877. Projet approuvé avec le plan par la Loi du 11 juillet 1879.
- Après de nombreuses délibérations nationales, départementales et communales, comme ici dans notre village :
1892
13 novembre 1892: VILLESÈQUE. Maire: M.Bouscat.
Le Président expose à l'assemblée que le chemin de fer de Cahors à Moissac se
fera sans tarder.
Vœu : demande que le tracé soit fait par la vallée de la Barguelonne et qu'une
station soit construite à l'embranchement des routes no 61 et no 67, point central
pour le développement des commerces des communes environnantes de : Cézac,
Lascabannes, Trespoux, Saint‑Cyprien, Cambayrac et Sauzet.
- Après aussi quelques évolutions du projets, les travaux vont pouvoir commencer en 1914.
11 janvier 1914 :
Début officiel des travaux.
7 juillet 1914 : Tracé et nivelage de l'axe de la voie terminé.
1er août 1914 , Arrêt du projet suite à une déclaration de guerre.
Octobre 1914 : Reprise des études et des travaux qui seront poursuivis pendant toute la durée de la guerre de 1914 à 1918.
La construction de la ligne Cahors ‑ Moissac d’ une longueur totale de 64.7 km dont environ 5 km sur la commune de Villesèque, était prévue pour une durée de 3 ans.
Sur le territoire de la commune de villesèque les ouvrages d’art suivants vont être construits :
Km 6.9 un PRA pour le chemin de la Pelissière.
Km 7.7 un PRO pour la route de la Pélissière Trespoux. (démoli en 2005)
Km 10.3 La gare un PRO pour la gare de Villesèque.
Km 11 un PRA pour le chemin de Bourdille.
Km 12.1 une tranchée pour le chemin du moulin de Ressigeac.
1918
24 mai 1918 :
Avant‑projet définitif approuvé.
Haltes et stations desservies : Cahors ‑ Labastide‑Marnhac ‑ Trespoux ‑ La Pélissière
Villesèque ‑ Saint‑Pantaléon ‑ Montcuq ‑ Sainte‑Juliette ‑ Lauzerte ‑ Montagudet
Miramont ‑ Castelsagrat ‑ Les Gervaises ‑ Moissac.
Les travaux d’infrastructure durerons jusqu’en 1930.
En Juillet 1933: Le Conseil National Economique rangea le projet dans la catégorie des lignes à classer en deuxième urgence. La conjoncture n'était plus guère favorable à l'établissement d'une ligne déjà jugée déficitaire.
Avant même les travaux, un service d'autobus de Cahors à Moissac longeait la ligne sur 42 km.
Le 19 octobre 1934 : Le Directeur du contrôle des lignes nouvelles proposa d'ajourner la construction de la superstructure. Le même jour, Le Ministre des Travaux Publics informa les Compagnies P.O.(Paris Orléan) et du Midi qu'il était disposé à engager la procédure de déclassement. Soixante cinq millions de francs environ ont été engloutis dans ce projet.
ETUDE DE RENTABILITE :
‑ DÉMOGRAPHIE DE LA POPULATION DE LA LIGNE
Avant de construire une ligne ferroviaire, on étudie en premier lieu, la faisabilité de son tracé, les différentes correspondances, mais aussi et surtout, la densité de la population qui habite aux extrémités et tout le long de la ligne.
Cette densité de population est un facteur très important. Il permet de déterminer le nombre et la fréquence des utilisateurs des moyens de communications ferroviaires mis à leur disposition. Ce nombre permet aussi de connaître approximativement la recette annuelle et l' équilibre financier pour le coût global du fonctionnement de la ligne. Il permet également de voir s'il y aura à long terme des bénéfices ou du déficit.
Mais à la lecture du tableau démographique établi pour les recensements de la population de 1876 à 1990, on s'aperçoit qu'à partir des années 1900 la population active des communes rurales est allée en décroissant, et cela jusqu'aux années 1990.
La cause de ce phénomène de décroissance est due, en partie, à l'évolution de l'industrie, au phylloxéra qui a détruit tout le vignoble dans la région du Quercy, et aux deux guerres mondiales des années 1914/1918 et 1939/1945. Cette décroissance a été encore plus marquée dans les années suivantes à cause des nouveaux besoins de la société actuelle et des nouveaux facteurs économiques qui ont obligé les populations rurales et urbaines à quitter leurs emplois d'origine pour s'orienter dans des secteurs de travail différents.
Ainsi, la ligne Cahors‑Moissac aurait peut-être vécu jusqu'en 1960, 1970, malgré les différentes lignes de correspondance à ses extrémités, telles que Paris‑Toulouse, Cahors‑Capdenac, Cahors‑Libos, et Bordeaux‑Sète avec, comme prévu, le prolongement de la ligne Cahors‑Moissac sur Castelsarrasin, Beaumont‑de‑Lomagne, Gimont, Lombez ou Lannemezan.
Mais il faut savoir aussi que le prolongement de la ligne n'a pas eu lieu au delà de Beaumont‑de‑Lomagne et que le tronçon de la ligne Beaumont‑Gimont est resté inachevé et a été aussi déclassé dans la même année que la ligne Cahors‑Moissac en 1941.
Donc, on peut estimer que la ligne ferroviaire de Cahors à Moissac n'aurait eu qu'une certaine durée de vie à cause, en grande partie, de la décroissance rapide de la population rurale et du manque de prolongement de la ligne pour permettre un déplacement plus aisé de la population dans le domaine du travail, du commerce et des loisirs.
|
|
|||||||
|
Recensement de la population entre les années 1876 et 1990 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Villages limitrophes de la ligne Cahors Moissac autour de la gare de Villesèque. |
|
||||||
|
Les chiffres du Lot et de Cahors sont donnés pour information. |
|
||||||
|
|
1876 |
1881 |
1901 |
1921 |
1954 |
1975 |
1990 |
|
LOT |
276 512 |
280 269 |
226 720 |
176 884 |
147 754 |
150 778 |
155 816 |
|
Cahors |
13660 |
15524 |
14018 |
11 866 |
15 384 |
21 903 |
20 787 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Villesèque |
818 |
862 |
605 |
509 |
304 |
234 |
298 |
|
Sauzet |
731 |
766 |
559 |
438 |
444 |
371 |
371 |
|
Carnbayrac |
274 |
309 |
235 |
154 |
90 |
77 |
111 |
|
Saint-Cyprien |
607 |
593 |
507 |
386 |
351 |
298 |
307 |
|
Trespoux-Rassiels |
675 |
665 |
508 |
278 |
187 |
216 |
576 |
|
Cezac |
487 |
511 |
352 |
233 |
182 |
143 |
145 |
|
Lascabanes |
651 |
637 |
513 |
345 |
263 |
173 |
158 |
- Trafic escompté
La ligne traverse une région dépourvue d'industries. Assez aride entre Labastide-Marnhac et Montcuq, cette région ne présente une production agricole susceptible de donner lieu à un trafic intéressant qu'aux environs des stations de Villesèque, de Montcuq, de Lauzerte et de Miramont‑Montesqieu.
Le trafic éventuel de ces quatre stations est évalué annuellement à 4.300 tonnes environ en G.V. (fruits, primeurs, raisins en particulier) et à 5.700 tonnes environ en P.V. (principalement vins, blé et maïs). La ligne n'aura donc pas à assurer un trafic local important de marchandises.
Les localités situées sur le parcours de la LCM sont déjà desservies par un service automobile qui relie Cahors à Moissac.
- Résultat financier de l'exploitation de la ligne
En se basant sur les résultats afférents à des lignes présentant quelque analogie avec la ligne Cahors‑Moissac, on peut évaluer de la façon suivante et selon le mode d'exploitation envisagé, le bilan financier de l'exploitation de la ligne en question (compte tenu des charges de capital à supporter par le réseau) :
‑ Exploitation dans les conditions primitivement prévues (construction de toutes les stations) :
‑ Dépenses d'exploitation ... 3.360.000 Fr
‑ Charges financières
(à la charge de la Cie)..............105.000 Fr
Total des dépenses d'exploitation
et des charges financières ...... 3.465.000 Fr
‑ Recettes probables ........ 1.350.000 Fr
‑ Déficit d'exploitation ... 2.115.000 Fr
On peut envisager, afin de réduire autant que possible le déficit d'exploitation, de ne pas construire les stations les moins importantes dont le déficit sera en proportion plus élevé, conformément au précédent de la ligne de Lérouville à Pagny‑sur‑Moselle.
Dans cette hypothèse, on ne construirait que les stations de Villesèque, Montcuq, Lauzerte et Miramont‑Montesquieu. L'économie réalisée sur les travaux de superstructure serait ainsi de l'ordre de 6.000.000 francs.
En résumé
Le trafic marchandises à escompter est peu important. La recette supplémentaire qu'il apportera aux autres lignes du réseau sera faible. En raison de l'éloignement des localités et de leur situation sur des collines élevées d'où elles surplombent la ligne, les voyageurs seront mal desservis.
Aussi, étant donné qu'il existe déjà des lignes d'autobus traversant la région et compte tenu d'une part des dépenses importantes qui restent à faire pour achever la ligne (de l'ordre de 50.000.000 de francs), d'autre part du déficit d'exploitation important qui est prévu, nous n'aurions pas d'objection à ce que la ligne de Cahors‑Moissac fût classée en 2ème urgence.
Enfin, si la construction de la ligne était décidée, nous serions d'avis d'adopter pour son exploitation la 3ème solution envisagée ci‑dessus : construction des quatre stations de Villesèque, Montcuq, Lauzerte et Miramont-Montesquieu seulement, substitution d'autobus aux trains de voyageurs, maintien d'un train de marchandises ou mixte.
TÉMOIGNAGES ET ANECDOTES
- Témoignage de M. Georges Alix Blanc
J'ai commence a travailler à la ligne comme mousse, j'avais 12 ans. Je travaillais chez COLOMB, entrepreneur des Travaux Publics. Je faisais toutes les petites commissions pour les ouvriers des chantiers. Je portais de l'eau, du vin, des outils pour les faire affûter etc.. Employé au début en 1922 en tant qu'apprenti, je gagnais 7 francs par journée de travail. En 1929 en tant qu'ouvrier, je gagnais 30 francs par jour. On faisait des journées de 10 heures en été et de 8 heures en hiver. Le moyen de transport était le vélo, on se levait à 5 heures du matin.
- Autres témoignages:
En 1920, il y a eu une grève des cheminots pour des augmentations de salaires. Elle a duré 1 mois. L'armée a été réquisitionnée pour accompagner les conducteurs de trains.
Les équipes travaillant sur la ligne étaient composées d’ une trentaine d'ouvriers : des Espagnols, des Portuguais, des Italiens et des Français. Il y avait 50% de Français et 50% d'immigrés.
Lauzerte, il y avait le transporteur Capitaine, on dit que Capitaine a fait arrêter la ligne... A Lascabannes, il y avait le transporteur Pignière pour les marchandises.
La cantine où se restauraient les ouvriers était située au lieudit "La Montagne", au bout de la côte du Cluzel. La serveuse s'appelait Raymonde, on dansait avec elle en mettant 10 centimes dans le piano automatique.
Ci-dessous:
3 copies de documents corcernant Monsieur André CARRENO habitant de Villesèque et travaillant sur la LCM .
1 copie de convocation de propriétaire pour reception de travaux sur ouvrage desservant les terrains longeant la voie.
CONCLUSION
Cahors‑Moissac, pourquoi cette ligne ferroviaire est restée inachevée, n'a jamais entendu le train du chasselas siffler ni vu le panache de fumée de sa locomotive ?... C'est la question toute simple que tout le monde se pose encore en 1998. Voici donc des éléments de réponse à votre question.
Après toutes les recherches d'archives et les récits des personnes rencontrées témoins de l'époque 1920 et encore en vie, on peut déjà dire que le principal adversaire de la ligne Cahors‑Moissac a été la concurrence de la route. Il me paraît donc être que plus une région est déshéritée et plus les partisans de la route défendent leur monopole avec force et opiniâtreté.
Mais le principal adversaire du projet pour la construction de la ligne LCM se trouve situé dans le mot clef rivalité.
Une première, la plus marquante, et peut-être encore aujourd'hui, est celle qui est administrative entre les deux départements du Lot et du Tarn‑et‑Garonne. La cause est la création du département du Tarn et Garonne lors du passage de Napoléon 1 er à Montauban en novembre 1808. Un morceau du département du Lot a été englobé dans le nouveau département du Tarn‑et‑Garonne. Avant 1808, les régions de Montauban, Moissac et Lauzerte étaient incluses dans la superficie du département du Lot. Je pense que la ligne de Cahors à Moissac aurait été construite en totalité si le département du Lot avait gardé sa superficie d'origine qui correspondait à l'ancienne province du "Quercy" formée à partir de terres nobles.
Bien après cette séparation en 1882, le vote pour les subventions nécessaires à l'acquisition des terrains de la ligne LCM a été retardé de 10 ans par le département du Lot. De plus, un évènement nouveau est intervenu entre 1882 et 1886. La commande nationale de fabrication de rails, qui était
prévue pour 400.000 tonnes, a été réduite à 300.000 tonnes en raison d'une grande crise économique. La ligne LCM fut touchée par cette mesure : elle a été déclassée d'intérêt général en intérêt local.
Une deuxième rivalité assez importante fut celle qui a existé entre les compagnies du P.O (Paris Orléan). et compagnie du Midi. Le P.O. qui date de 1838 et qui a fusionné avec des Cies voisines en 1852 ne souhaitait pas, à cette époque, alimenter en voyageurs et en fret le réseau de la Cie du Midi.
Une troisième fut la guerre de 1914‑1918 dont la priorité imposa quatre années de retard pour la construction de la ligne.
Une quatrième fut la concurrence de la route, due aux transporteurs routiers de Cahors, de Lascabanes et de Lauzerte, qui ont usé de toute leur influence pour enliser ce projet ferroviaire contraire à leurs intérêts.
La cinquième et dernière rivalité était due à la concurrence des commerçants de la ville de Moissac qui avaient peur de perdre des clients avec la disparition du marché du chasselas et l'arrivée de ce chemin de fer pourtant désirée par les riverains.
Malgré toutes ces rivalités, il nous restera aujourd'hui de nombreux souvenirs de cette très longue aventure, avec une trentaine de kilomètres de plate-forme encore visibles à travers une végétation assez envahissante et de nombreux ouvrages d'art toujours présents, surtout côté Cahors.
Si le projet de construction de la ligne du chemin de fer de Cahors à Moissac a duré 56 ans, celui des recherches et de l'élaboration de l'ouvrage d’où sont extraites ces lignes aura été conclu en 3 ans, grâce à l'efficacité d'une équipe d'amis fidèles et passionnés, pour votre plus grand plaisir.
Les extraits ci-dessus portent surtout sur la partie concernant la commune de Villesèque ; vous en apprendrez beaucoup plus en faisant l’acquisition de l’ouvrage lui-même qui est très complet et que vous trouverez en vente en gare SNCF de Cahors
CAHORS-MOISSAC, Une ligne ferroviaire oubliée, de Paul DAUSSE Editeur:Photo club SNCF-UAICF Cahors.